

REPLAY
PHILOSOPHIE
TOUT PUBLIC
Présentation
La semaine de la philo débutera le 11 juin au Théâtre Princesse Grace. Charlotte Casiraghi, Présidente et Fondatrice des Rencontres Philosophiques de Monaco en parle.
CONTENU SIMILAIRE
REPLAY
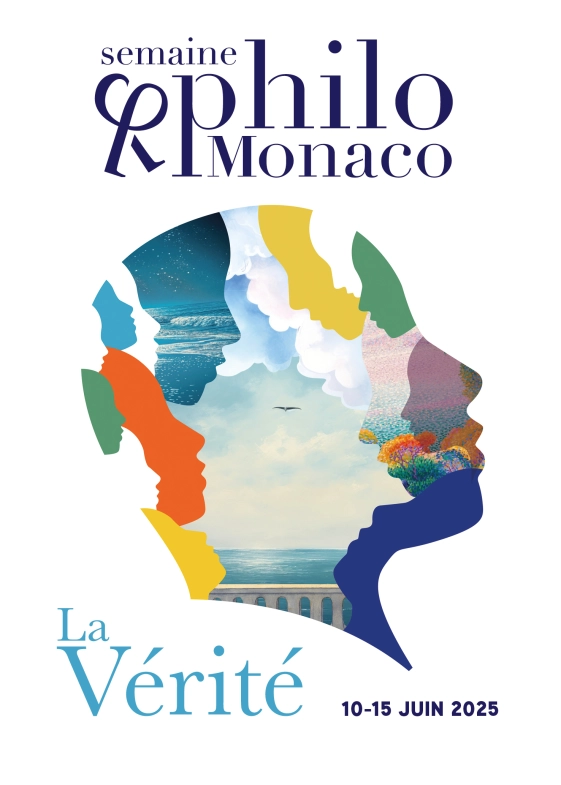
La vérité sur le divan
13
Juin
20
25
Présenté par Judith Revel, philosopheAvec Isabelle Alfandary, auteure et professeureStéphane Habib, psychanalyste et philosopheLaurie Laufer, psychanalyste et professeure de psychanalyseIl s’en passe des choses, sur un divan. Mais pas celles qu’on croit. Les jeux n’y sont que de mots, une parole en sort, tantôt jaillissante et irréfrénable, tantôt hésitante, tremblotante, entrecoupée de silences et de sanglots, une écoute en naît, rarement distraite, flottante et attentive. Qu’est-ce qui se noue, ou se dénoue, dans cette étrange conversation ? Le divan entend et voit tout: les mots, les silences, les notes, les tics, les mouvements du corps de l’analyste, les mots, les silences, les mouvements du corps couché de l’analysant, ses histoires, ses récits, ses rêves, ses lapsus, ses associations libres, l’expression de ses émotions, de ses désirs, de ses hantises, de ses gouts et dégouts, de ses peurs, ses résistances, ses espoirs, ses projets… Perçoit-il aussi, le divan, l’émergence au fil des séances d’une « vérité » ? Devient-il le lieu où thérapeute et analysé(e) se modifient l’un l’autre et accèdent chacun(e) à une plus nette conscience de ce qu’ils sont ? Est-il l’«assise» sur laquelle le «patient» se redresse et se reconstruit, se fait sujet, en consentant aux « vérités » que son inconscient lui révèle, en acceptant d’être ce qu’il est devenu et de devenir ce qu’à présent, par lui-même, il sait pouvoir devenir ?
Proposé par :
Rencontres Philosophiques de Monaco
PHILOSOPHIE
Tout public
FR
REPLAY
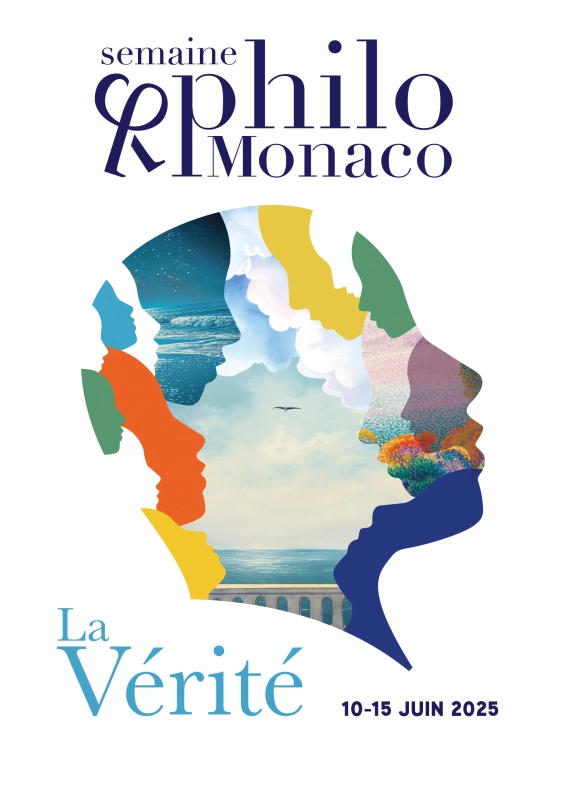
Fake news, vérités et complots
13
Juin
20
25
Présenté par Géraldine Muhlmann, philosophe et journalisteAvec David Djaïz, haut fonctionnaire et essayisteAsma Mhalla, enseignante, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la TechRudy Reischtag, politologue, écrivain et journalistePatrick Savidan, philosopheTout changement du canal d’information provoque des bouleversements, moins sur l’information elle-même que sur la société, la civilisation même, et bien sûr les façons d’agit et de penser. Inutile de remonter au pigeon voyageur ou à l’invention de l’imprimerie: le télégraphe sans fil, on ne s’en souvient guère, a provoqué un véritable hourvari social et politique, les uns y voyant un miracle divin, d’autres l’œuvre du démon. Les pionniers d’internet et du Web espéraient qu’un canal numérique ouvert à l’information et à la communication pût ouvrir à tous et toutes la possibilité d’une expression propre, libre et aisée, dont chacun(e) aurait le loisir de faire usage et participer ainsi, sur le modèle d’un Wikipedia idéal, à l’édification d’un royaume des savoirs et de la connaissance, transparent, fiable. Ce n’est pas ce qui est arrivé. La révolution numérique, Internet, le Web, le réseau superposé du Darknet, les smartphones, les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle, causent non des bouleversements mais un véritable chaos, où coexistent le meilleur et le pire, et créent un « autre » monde que les outils dont on disposait dans ce monde-ci ne permettant pas de comprendre entièrement. La victime principale en est aujourd’hui la vérité elle-même, considérée, à l’instar d’une peinture métallisée pour une voiture, comme une simple option, facultative. L’anonymat aidant, sont apparues des millions de sphères autonomes et incontrôlées dans lesquelles pseudo-théories, croyances, simples avis, fadaises, incompétences, complotismes font office d’« information », et forment en fait des marécages brumeux où nul ne sait plus ni où il est ni ce qu’il en est des choses. Comment se tirer des sables mouvants, quand la conversation sociale devient si nerveuse, quand la science elle-même est soupçonnée et décriée ?
Proposé par :
Rencontres Philosophiques de Monaco
PHILOSOPHIE
Tout public
FR
REPLAY
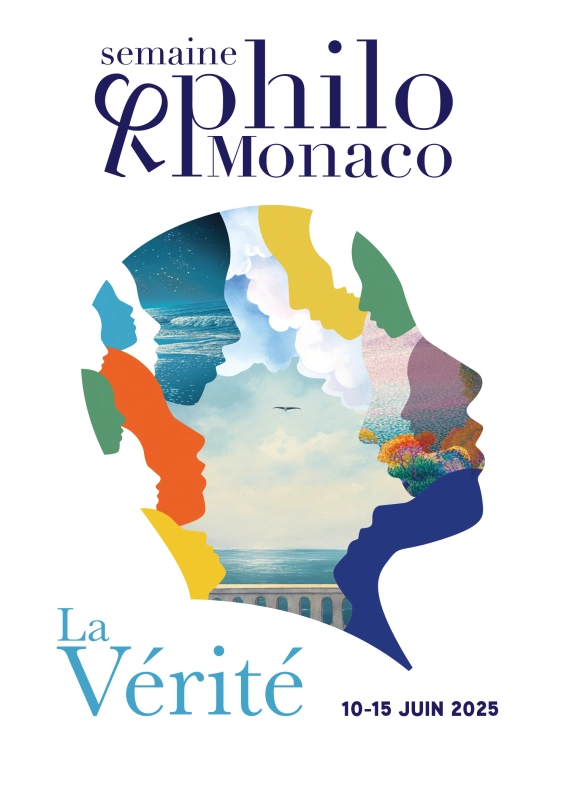
La difficulté de dire et de faire entendre la vérité
12
Juin
20
25
FemmesPrésenté par Laurence Joseph, psychologue et psychanalysteAvec Florence Askenazy, psychiatre et professeure de psychiatrieSoinPrésenté par Robert Maggiori, philosopheAvec Flora Bastiani, philosopheDr. Jean-François Ciais, Chef de Service de Soins de Support et Soins Palliatifs du CHPGQuand la vérité « éclate », elle le fait non comme fusil qui vise une cible, mais comme un engin de terreur, qui, aveugle, explose tous azimuts, frappant tout le monde de ses éclats - une famille, une foule, une communauté, une société. C’est pourquoi, difficile à dire quand son détenteur en sait l’importance et évalue bien les conséquence de son dévoilement, la vérité est encore plus difficile à entendre, lorsqu’elle balaie tout ce à quoi on croyait et tout ce avec quoi on avait construit son existence. En ce sens, la difficulté de dire la vérité décroît si sa révélation s’accompagne de la conscience que la personne (ou le groupe, la communauté…) qui la reçoit est « armé » pour la recevoir, c’est à dire est capable d’intégrer les éléments révélés dans la construction de sa propre vie (ses valeurs, ses perspectives, ses espoirs…) ou celle du groupe concerné. La difficulté apparaît plus grande au contraire quand la vérité - ou la réalité d’un fait, une trahison, une maltraitance, une humiliation… - « ne peut pas » être entendue parce que cette capacité fait défaut: c’est le cas de l’enfant par exemple, qui pourrait ne pas avoir la force intellectuelle ou la résistance émotionnelle pour «entendre» et assimiler l’annonce du divorce imminent de ses parents ou de la disparition d’un camarade de classe; le cas d’une femme qui subit des violences qu’elle n’arrive ni à avouer ni à dénoncer parce que l’emprise subie maintient encore une part d’attachement, ou parce qu’elle ne parvient pas à faire que la honte champ de camp ; le cas d’un individu à peine inquiet de quelques troubles de son comportement qui découvre le diagnostic d’une sérieuse maladie mentale; le cas d’une personne dont la vie est précaire et le psychisme vulnérable, à qui un médecin doit révéler une maladie cancéreuse, ou encore le cas d’un patient en soins palliatifs, qui se trouve dans l’impossibilité d’inscrire ce qu’on peut lui dire dans une temporalité, le futur des projets. La vérité serait-elle comme le soleil, qu’on ne peut « regarder en face » ?
Proposé par :
Rencontres Philosophiques de Monaco
PHILOSOPHIE
Tout public
FR